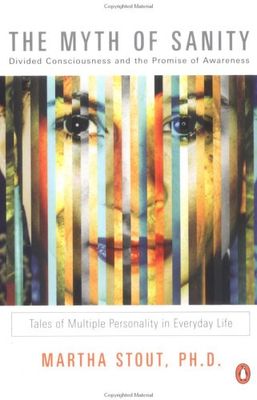Nous sommes tous exposés à des traumatismes psychologiques à un moment donné de notre vie ; pourtant, la plupart d’entre nous sont inconscients des zones brumeuses que laissent dans nos cerveaux les expériences traumatisantes, puisqu’en général, nous ne vivons ces expériences que de façon indirecte.
Mais nous nous sentons un peu « dérangés » et ridicules, lorsque, de temps à autre, nous sommes incapables de nous souvenir d’un événement simple dont nous devrions pourtant être capables de nous rappeler. (« les premiers signes d’Alzheimer », diront les gens en plaisantant – d’un ton peut-être pas morbide, mais pas si enjoué que cela non plus.)
Nous ressentons aussi notre insanité, et, parfois, l’impression quasi frénétique d’avoir perdu le contrôle de notre vie, lorsque nous vivons des conflits et des malentendus avec nos proches, lors de ces mêmes disputes émotionnellement confuses qui reviennent en boucle sans arrêt. Les conflits ne tuent pas vraiment l’amour que nous ressentons, mais ils n’en cessent pas pour autant. Et en tant que société, nous nous sentons incompétents et désespérément impuissants face au taux alarmant de mariages ratés.
Nombre d’entre nous marchent sur des oeufs avec leurs partenaires, qui sont pourtant – en théorie – les personnes que nous devrions connaître le mieux. Nous nous comportons ainsi parce que nous vivons sans cesse dans la crainte que notre compagnon ou conjoint ne se fâche ou ne sombre dans le mutisme, n’entre dans une rage folle suite à un événement ou à quelque chose que nous aurions dit, ne devienne distant, ou ne se transforme en parfait étranger sous nos yeux.
Ou alors, nous voyons vieillir nos parents, et, remarquant que le temps file, nous aspirons à être plus proches d’eux, à les connaître en tant qu’amis. Mais lorsque nous nous mettons à y réfléchir sérieusement, nos pensées nous échappent telle de l’eau filant entre les doigts et, l’instant d’après, nous avons l’esprit ailleurs – n’importe où : sur la hausse du prix du pétrole, sur ce rapport que nous devons rendre au travail, sur une tache sur le tapis.
Nombre d’entre nous jugent difficile, voire parfois impossible, de fonctionner sur un seul « mode », d’être constant et reconnaissable, même à nous-mêmes. L’un des exemples les plus universels de cet état de fait est l’expérience du retour « à la maison », chez les parents. Après une visite à la famille, on se fait souvent cette réflexion (soit mentalement, soit à voix haute, devant des amis) : « Je me transforme en quelqu’un d’autre. Je n’y peux rien. C’est plus fort que moi. Tout à coup, j’ai à nouveau treize ans. » Nous sommes des adultes à part entière ; peut-être même nous considérons-nous comme des personnes sophistiquées. Nous comprenons de quelle manière nous devons agir, nous savons ce que nous voulons dire à notre mère, à notre père. Nous avons des plans. Mais une fois que nous sommes là-bas, nous ne pouvons nous y conformer – car soudain, nous ne sommes plus vraiment là. Des enfants dépendants, en quête d’affection et incontrôlables ont investi nos corps et agissent à notre place. Et nous sommes impuissants à ramener notre véritable « moi » tant que ne sommes pas repartis de « chez nous ».
Le pire dans tout cela, c’est que plus le temps passe, plus nous avons l’impression de nous engourdir, d’avoir perdu quelque chose – une certaine vitalité que nous possédions jadis. Bien que nous n’en parlions pas beaucoup entre nous, nous devenons nostalgiques de notre propre moi. Nous tentons de nous rappeler l’exubérance, et même la joie, que nous ressentions auparavant dans ce que nous faisions. En vain. Mystérieusement, et avant même que nous ayons conscience de ce qui se passe, nos vies sont transformées. Imagination et espoir disparaissent, laissant la place à une vie où nous subissons jour après jour, une vie où il « faut faire avec ». Souvent, nous parvenons à entrevoir un long chemin semé d’embûches épuisantes, chemin qui mène à un lieu dont nous ne sommes même plus certains qu’il soit notre destination souhaitée. Au lieu de faire des rêves, nous ne faisons guère que nous protéger. Nous dépensons notre force vitale, précieuse et limitée, dans le « damage control ».
Et tout cela à cause d’événements traumatisants qui ont eu lieu dans un passé lointain, qui ont pris fin dans un passé lointain et qui, dans la réalité actuelle, ne représentent absolument plus aucun danger. Comment cela se peut-il ? Comment les terreurs enfantines et adolescentes qui auraient dû prendre fin il y a des années peuvent-elles perdurer et nous rendre fous et étrangers à nous-mêmes dans le présent ?
Paradoxalement, cet état de fait trouve son explication dans une fonction parfaitement normale de l’esprit connue sous le nom de dissociation. La dissociation est la réaction universelle des humains face à la peur ou à la douleur. Lors de situations traumatisantes, la miséricordieuse dissociation nous permet de déconnecter le contenu émotionnel – la partie de notre « moi » qui ressent – de notre état de conscience normal. Ainsi déconnectés de nos sentiments, nous avons plus de chances de survivre à l’épreuve, de faire ce qu’il faut, de surmonter un moment critique durant lequel nos émotions ne feraient qu’obstacle. La dissociation permet de contempler un événement traumatisant en temps réel, presque comme si nous en étions les spectateurs, et cette séparation entre émotions d’une part et pensées et action d’autre part – la perspective du spectateur – peut nous éviter d’être totalement submergés par ce qui se passe.
Une réaction dissociative modérée – après un accident de voiture, par exemple – sera typiquement exprimée en ces termes : « C’est comme si je me regardais vivre l’accident. Je n’avais même pas peur. »
La dissociation durant un traumatisme est extrêmement adaptative ; c’est une fonction de survie. Le problème ne surgit que plus tard : bien après que l’événement a pris fin, la tendance à être déconnecté de nous-mêmes peut demeurer. Nos vieilles terreurs nous entraînent à devenir dissociatifs, à nous protéger en nous éloignant psychologiquement pendant quelques instants d’une réalité devenue trop effrayante ou pénible. Or, il est possible que ces petits « breaks mentaux » se manifestent par la suite lorsque cela n’est pas nécessaire ni souhaitable – ni reconnaissable. Sans raison manifeste, nous quittons nos mois ; ceux que nous aimons quittent le leur également, et ces absences psychologiques inaperçues font des ravages dans nos vies et nos relations. […]
[Les t]raumatismes modifient le cerveau-même… [U]n cerveau psychologiquement traumatisé contient des bizarreries impénétrables qui le poussent à réagir de façon excessive – ou, plus précisément, de façon inappropriée – aux réalités présentes de la vie. Ces réactions neurologiques inappropriées finissent par s’enraciner, parce
que les traumatismes affectent en profondeur la sécrétion des neurohormones produites en réaction au stress (hormones telle que la noradrénaline), et ont donc un effet sur les diverses zones du cerveau impliquant la mémoire, notamment l’amygdale et l’hippocampe.
Via le thalamus, l’amygdale reçoit l’information sensorielle transmise par les cinq sens, y attache une signification émotionnelle, et transmet cette « évaluation » émotionnelle à l’hippocampe. En accord avec « l’évaluation » des priorités par l’amygdale, l’hippocampe est activé de façon plus ou moins grande, organisant alors la nouvelle donnée et l’intégrant aux informations déjà existantes concernant des événement sensoriels similaires. Dans des conditions normales, ce système fonctionne efficacement de sorte à consolider les souvenirs selon leur priorité émotionnelle. Toutefois, en cas de stimulation hormonale extrême – lors de situations traumatisantes – , un effondrement a lieu. Lorsque l’amygdale enregistre une signification émotionnelle bouleversante, l’activation de l’hippocampe se fait mal, ce qui l’empêche d’organiser efficacement ou d’intégrer aux autres souvenirs certaines de ces données traumatisantes. Il en résulte que des bribes de souvenirs traumatisants sont stockés non comme parties d’un tout unifié, mais comme images sensorielles et sensations physiques qui ne sont pas localisées dans le temps ni même replacées dans leur contexte, ni intégrées à d’autres événements.
Pour compliquer encore plus les choses, l’exposition à des traumatismes est susceptible de déclencher une fermeture de l’aire de Broca, la zone de l’hémisphère gauche cérébral qui traduit l’expérience en mots – le langage étant le moyen que nous utilisons en général pour relater nos expériences aux autres, et même à nous-mêmes.
Les souvenirs standards se forment grâce à l’apport adéquat de données hippocampiques et corticales, sont intégrés dans un tout cohérent, et leur sens est susceptible de se voir modifié par des événements ultérieurs et par le langage. Par contraste, les souvenirs traumatisants incluent, eux, des fragments désordonnés fermés à toute modification par des expériences ultérieures. Ce genre de bribes de souvenirs sont muets, atemporels et non localisés ; bien après que le traumatisme originel s’est évanoui dans le passé, les traces qu’en garde le cerveau ne sont que des bribes isolées et parfaitement anonymes d’émotions, d’images et de sensations qui résonnent en l’individu telle une alarme détraquée.
Pire encore, plus tard, lorsque la personne vivra des situations vaguement similaires au traumatisme – peut-être simplement en raison de leur caractère surprenant, anxiogène ou émotionnant – , les bribes de souvenirs transmises par l’amygdale seront plus facilement accessibles que les souvenirs plus complets et moins ostensibles qui ont été intégrés et modifiés par l’hippocampe et le cortex cérébral. Même si les souvenirs unifiés et mis à jour seraient plus appropriés dans le présent, les souvenirs de l’amygdale sont plus accessibles, ainsi le traumatisme peut revenir à la « mémoire » lors de moments inopportuns, en l’absence de danger digne d’un tel signal d’alarme. En réaction à un stress relativement banal, la personne traumatisée il y a longtemps pourra véritablement sentir que le danger est à nouveau imminent, et être assaillie de plein fouet par des sensations émotionnelles et physiques, voire des images, sons et odeurs qui ont un jour accompagné cette grave menace.
Illustrons cela par un exemple de la vie quotidienne. Une femme nommée Beverly attend son train dans une gare tranquille. Assise, elle lit son journal du matin. L’article, qui parle d’un gros scandale local, l’intrigue tellement que pendant quelques minutes, elle en oublie où elle est. Soudain, le rugissement assourdissant du train signalant son arrivée fait péniblement sursauter Beverly, qui redresse vivement la tête, le souffle coupé. Elle ne comprend pas comment elle a pu être aussi étourdie et décontractée en public. Son coeur bat la chamade, et tandis qu’elle plie son journal, elle est assaillie de sensations physiques, et même par une odeur qui n’a absolument rien à voir avec la gare dans laquelle elle se trouve en ce matin ordinaire. Si elle pouvait identifier cette odeur – ce qui n’arrivera jamais – elle dirait que c’est du « chlore ». Elle ressent une soudaine raideur dans la poitrine, comme si ses poumons venaient de se pétrifier, et a l’envie presque irrépressible de sortir d’ici, de s’enfuir en courant.
En un éclair, perceptuellement et émotionnellement parlant, le présent est devenu le passé. Ces bribes de sensations et d’émotions sont les souvenirs transmis par l’amygdale un après-midi d’été, il y a trente ans, lorsque Beverly, dix ans, rentrant à pied de la piscine municipale, a vu sa petite soeur se ruer sur la route et mourir sur le coup, renversée par une voiture roulant en excès de vitesse. Trente années plus tard, Beverly ressent la même chose qu’à cet instant-là.
Ses sensations et sentiments ne sont pas catalogués comme appartenant aux souvenirs liés à cet horrible accident. En fait, ils ne sont catalogués comme rien du tout, parce qu’ils ont toujours été totalement muets. Ils ne sont attachés à aucun récit, lieu ni instant, à aucune histoire qu’elle puisse raconter à propos de sa vie ; ils sont amorphes et ineffables.
Le cerveau de Beverly contient, de fait, un système d’alarme détraqué au niveau du système limbique, une vieille boîte de fusibles qui ont tendance à fondre sans raison valable, déclarant avec insistance une urgence là où il n’y en a pas dans le présent.
Ce qui est étonnant, c’est que Beverly ne s’interrogera probablement pas, ni même ne se rappellera ces intenses « signaux d’alarme » perceptuels et émotionnels, car en un rien de temps, un réflexe dissociatif ancré depuis longtemps dans son cerveau se sera sans doute déclenché en réaction à l’urgence déclarée, pour la « protéger » de ce souvenir d’enfance « insoutenable ». Elle pourra se sentir étrangement en colère, ou bien paranoïaque, ou encore comme une enfant effarouchée. Ou au contraire, elle aura peut-être l’impression désagréable de s’être mise à évoluer dans un monde fantasmatique cotonneux, lointain et irréel. Ou alors, elle pourra complètement quitter son « moi » pendant un instant, continuant à agir mais sans conscience de soi. Dans ce dernier cas, si la dissociation est mineure, elle pourra décrire la totalité de l’expérience en ces termes : « Aujourd’hui, alors que j’attendais le train pour aller au travail, le train est entré en gare – dans un bruit d’enfer ! – et sans que je comprenne comment, il était là, devant le quai. » Elle pourra même se moquer un peu de sa tendance à « planer ».
La plupart d’entre nous ne remarquent pas vraiment ces expériences. Elles nous sont plus ou moins invisibles, pris que nous sommes par notre routine quotidienne ; ainsi, nous ne réalisons pas à quel point, dans les faits, nous vivons notre vie quotidienne dans le passé, en réaction aux heures les plus sombres de notre vie. Nous ne comprenons pas non plus à quel point certains de ces souvenirs sont troubles et épuisent notre vitalité. Creusant le bourbier de notre conscience divisée, tout au long d’une vie, ces réactions mentales « protectrices » acquièrent la force de l’habitude. Ces muscles surentraînés peuvent nous faire sortir de nous-mêmes même lorsque les bribes de souvenirs traumatisants en question n’ont pas ressurgi. Parfois, la dissociation s’active lorsque nous sommes simplement désorientés, frustrés ou encore nerveux, que nous reconnaissions ou non nos absences.
Typiquement, seuls ceux qui ont subi les traumatismes les plus graves sont poussés à découvrir, et peut-être à remédier à ces départs du présent. Seules les addictions, les dépressions sévères, les tentatives de suicide et la ruine générale qui accompagnent les troubles les plus sévères consécutifs à des traumatismes fournissent une motivation suffisamment forte pour relever le défi d’adopter une nouvelle perspective et effectuer des changements permanents. Compte tenu de notre configuration neurologique, confronter les traumatismes du passé exige de revivre toutes leurs terreurs mentalement, dans leur intensité originelle, d’avoir l’impression que son pire cauchemar devient réalité et que les horreurs sont de retour. Toutes les alertes lancées avec force par le cerveau et empêchant de rester présent à soi-même pour revivre les souvenirs et les émotions douloureuses, tous les fusibles défectueux doivent être délibérément ignorés, et dans les cas de traumatismes passés extrêmes ou chroniques, ce processus a tout du parcours du combattant. […]
Tous les êtres humains sont doués de la capacité de dissociation psychologique, bien que la plupart d’entre nous en sont inconscients, et considèrent que les sorties « hors du corps » dépassent de loin les limites de notre expérience normale. En réalité, les expériences dissociatives concernent tout le monde, et la plupart d’entre elles sont tout à fait ordinaires.
Prenons comme exemple un individu lambda entrant dans un cinéma tout à fait ordinaire pour voir un film populaire. Il est éveillé, alerte, et sait s’orienter dans son environnement. Il est conscient du fait que sa femme est avec lui et, tandis qu’ils s’assoient sur les strapontins, qu’elle se trouve à sa droite. Il est conscient qu’il tient un cornet de popcorn sur les genoux. Il sait que le film qu’il est venu voir s’appelle « Le Fugitif », avec Harrison Ford dans le rôle principal. Tandis qu’il attend que le film commence, peut-être s’inquiète-t-il d’un problème qu’il doit régler au travail.
Mais les lumières s’éteignent dans la salle, et le film commence. Au bout de vingt-cinq minutes, l’individu a totalement perdu pied avec la réalité. Non seulement ne s’inquiète-t-il plus de son travail, mais il ne réalise même plus qu’il a un travail. Si l’on pouvait lire dans ses pensées, on découvrirait qu’il ne croit plus qu’il est assis dans une salle de cinéma, bien que dans les faits, ce soit le cas. Il ne peut sentir l’odeur du popcorn ; plusieurs grains se renversent du cornet, qu’il tient maintenant légèrement penché, parce qu’il en a oublié ses propres mains. Sa femme a disparu, bien que n’importe quel observateur verrait qu’elle est toujours assise à sa droite, à dix centimètres de lui.
Et sans bouger de son propre siège, il court, court, court – pas avec Harrison Ford, l’acteur, mais avec le fugitif du film ; autrement dit, avec une personne qui n’existe absolument pas, dans le monde réel de ce spectateur ou de n’importe qui d’autre. Son coeur s’emballe tandis qu’il évite un train qui file à toute allure – train lui aussi inexistant.
Cet individu tout à fait ordinaire s’est dissocié de la réalité. Concrètement, il est en transe. On pourrait qualifier ses perceptions de psychotiques, nonobstant le fait que lorsque le film sera fini, il retrouvera son état mental habituel presque instantanément. Il verra le générique de fin. Il remarquera qu’il a renversé du popcorn, bien qu’il ne s’en souvienne pas. Il regardera à sa droite et parlera à sa femme. Très probablement, il lui dira qu’il a aimé le film ; après tout, nous apprécions tous les divertissements dans lesquels nous pouvons nous perdre. Ce qui s’est en fait passé, c’est que, pendant un petit moment, il a pris la partie de lui-même qui s’inquiète des problèmes au travail et des autres choses « réelles », et les a séparées de la partie imaginaire de lui-même, de sorte que cette partie imaginaire puisse prendre le dessus. Il a dissocié une partie de sa conscience d’une autre partie.
Lorsque la dissociation est illustrée de cette manière, la plupart des gens sont disposés à admettre qu’ils vivent ce genre d’interludes de temps à autre, au cinéma ou au théâtre, en lisant un livre ou en écoutant un discours, ou simplement en rêvassant. Et alors, le terme « hors du corps » peut sembler trop proche de la réalité. Dit clairement, dans certaines circonstances – qui peuvent aller de la distraction, agréable ou non, à la peur, en passant par la douleur ou l’horreur – , l’être humain peut psychologiquement s’absenter de sa propre expérience directe. Nous pouvons partir ailleurs. La partie de la conscience que nous concevons la plupart du temps comme notre « moi » peut être absente pendant quelques instants, heures et, dans certaines circonstances terribles, encore plus longtemps. […]
Les patterns psychologiques et les effets premiers comportementaux de la distraction, de la fuite, de l’état dissociatif et de la transe sont quasi identiques, quelle que soit la méthode utilisée. Les différences qui les caractérisent semblent moins résulter de la façon dont la conscience se divise que de la fréquence et de la durée de cette division forcée. […]
Si vous observez des enfants en train de jouer, vous vous rendrez compte qu’ils sont particulièrement doués pour la dissociation. Pour les besoins du jeu, l’enfant peut, en un éclair, « sortir de lui-même », devenir quelqu’un ou quelque chose d’autre, ou plusieurs choses à la fois. La réalité est encore plus malléable dans l’enfance. Les jeux où l’on « fait semblant » sont réels, merveilleux et prenants. Un observateur attentif verra clairement que les enfants tirent une joie infinie de leur capacité supérieure à quitter leur propre « moi » et à partir ailleurs, à devenir autre chose. La neige n’est pas froide. Le corps n’est pas fatigué, même lorsqu’il est au bord de l’épuisement.
Parce que les enfants se dissocient facilement même dans des circonstances ordinaires, lorsqu’ils se retrouvent face à des situations traumatisantes, ils divisent facilement leur conscience en plusieurs parties, souvent pour des périodes étendues. La moi est mis de côté et enfoui. Bien sûr, cette réaction est fonctionnelle pour l’enfant traumatisé ; elle est nécessaire, voire bénéfique. Pour l’enfant traumatisé, un état dissociatif, loin d’être dysfonctionnel ou dément, peut en fait lui sauver la vie. […]
Cette stratégie de survie ne devient dysfonctionnelle que plus tard, après que l’enfant a grandi et est à l’abri du traumatisme originel. Lorsque ce dernier n’est plus un fait continu de l’existence, les réactions dissociatives prolongées ne sont plus nécessaires. Mais les années d’utilisation intensive ont rendu la stratégie d’auto-protection épidermique. L’adulte qu’est devenu l’enfant réagit désormais de façon
dissociative à des niveaux de stress qui ne pousseraient probablement pas une autre personne à se dissocier. […]
Aux commencements de notre espèce, les chances de survie d’un nouveau-né humain n’étaient sans doute pas plus grandes que celle d’un bébé-tortue de mer nouvellement éclos se ruant pour atteindre la mer sur une plage survolée par une nuée de mouettes ; notre passé primordial est marqué par une incroyable vulnérabilité aux attaques. Nos corps et nos cerveaux furent forgés dans le feu incandescent et, à l’aube d’un nouveau millénaire, nous demeurons le produit de ces débuts lointains.
Comme les bébés-tortues, notre première tâche était de nous mettre en sûreté. Mais au contraire des tortues, nous avions évolué en tant que créatures complexes, aux facultés cognitives astucieuses, aux capacités de représentations mentales. Nous étions conscientes que nous pouvions être blessées, avoir mal, mourir. Nous comprenions les dangers réels, et aussi nombre de dangers potentiels. Nous considérions, planifiions, rêvions, craignions. Pour raisons évidentes, nos puissants cerveaux nous donnaient un gros avantage dès lors qu’il s’agissait de survivre aux dangers de la planète ; mais à cause de leurs effets un peu moins manifestes, ces cerveaux complexes étaient aussi un handicap. Pour faire une analogie, imaginez qu’un bébé-tortue devienne conscient de la possibilité qu’une mouette puisse, en quelques instants, briser sa frêle coquille et gober sa chair. Que se passerait-il si cette conscience soudaine poussait le reptile nouveau-né à se figer de terreur au beau milieu de la plage, au lieu de continuer sa course inconsciente vers la mer ? Elle serait tuée sur le champ, évidemment. Elle n’aurait jamais la chance de pondre ses propres oeufs.
Ainsi, la conscience est-elle à la foi une bénédiction et une malédiction, dès lors que la survie est en jeu. Même les animaux, lorsqu’ils sentent des prédateurs dans leur environnement proche, réduisent leur champ perceptuel, et il a été démontré que leurs corps subissait une opportune analgésie lorsqu’ils étaient attaqués. Les êtres humains ont mitigé la malédiction que représentait leur conscience plus évoluée grâce à une palette de facultés dissociatives sophistiquées qui leur permettent souvent de fonctionner de façon efficace lors de circonstances terrifiantes. […]
Notre élasticité mentale lors de circonstances pétrifiantes est normale. Mais en quoi les circonstances désespérées sont-elles, elles, normales ? À l’aube d’un nouveau millénaire, les monstres qui assaillent les êtres humains sont-ils devenus si rares que cela ? Combien de ces monstres subsistent-ils, en cette ère technologique ? Voici la réponse, mais soyez prévenus, elle n’est pas agréable :
Souvent, aujourd’hui, les visages des monstres sont différents ; mais nous vivons dans un monde qui agresse encore la conscience de tous ses enfants. Le fait que la plupart d’entre nous ne se considèrent pas comme traumatisés peut en partie être vu comme un hommage à l’esprit humain
La maltraitance infantile… n’est qu’un premier exemple, bien que, selon le National Committee to Prevent Child Abuse [Comité national contre la maltraitance infantile – NdT], environ quarante-sept enfants étasuniens sur mille sont signalés pour mauvais traitements aux différents services de protection de l’enfance. Dans une estimation à minima (pour des cas signalés ou non), trente-huit pour cent des filles et seize pour cent des enfants au total sont abusés sexuellement avant l’âge de dix-huit ans.
Le fait que les enfants soient témoins de violence est une caractéristique établie de nos vies. Rien qu’aux États-Unis, les dépenses de santé pour violence domestique totalisent de trois à cinq milliards de dollars par an. Hors de la sphère familiale et au niveau urbain – selon une étude conduite par des étudiants de l’American Psychological Association à Washington, D.C. – quarante-cinq pour cent ont rapporté avoir assisté à des agressions, trente-et-un à des fusillades, et trente-neuf rapportent avoir vu un cadavre.
Mais au-delà de ces statistiques, on trouve les cas d’enfants parfaitement ordinaires, issus de familles non violentes et qui ne vivent pas dans des quartiers déshérités. Même les enfants qui ne sont pas maltraités consciemment, même ceux qui ne sont pas directement exposés au crime assistent aux colères et querelles parentales à la maison, et sont exposés aux actualités rapportant les événements les plus horribles du monde extérieur. Dit clairement, la liste des événements agressant la conscience et que subissent ou auxquels assistent les enfants même les plus protégés est extrêmement longue : accidents graves, accidents de voiture, maladie et mort d’êtres chers, brimades subies ou simplement craintes, procédures médicales terrifiantes, batailles dévastatrices pour la garde des enfants, prédictions de destruction nucléaire ou de l’environnement, leçons macabres sur la façon d’échapper à « l’inconnu » auquel les parents protecteurs s’attendent toujours.
Mais nous devons aussi considérer d’autres situations plus fondamentales : par exemple, la vulnérabilité première inhérente à l’existence dans un corps humain – la douleur physique inévitable, et, pour certains, la perte des fonctions physiques ou la perte de membres causées par la maladie, un accident ou une anomalie génétique. Ou pour prendre un autre exemple, la lutte quotidienne de familles qui, sur toute la planète, craignent pour leur sécurité émotionnelle ou physique en raison de caractéristiques immuables telles que la race ou l’appartenance technique.
Nous vivons dans des corps fragiles au sein d’un monde dangereux, surtout lorsque des enfants sont concernés, et si nous prenions un instant pour réfléchir à nos expériences, nous découvrions que, bien que nous n’ayons pas tous subi des abus, nul n’est complètement indemne, pas même en notre ère technologique.
Mais j’ai parlé spécifiquement des traumatismes psychologiques, pas du danger ou de la douleur en général. Quelle est la définition d’un traumatisme psychologique ? Quel genre de situations et d’événements sont traumatisants, par opposition à simplement douloureux ou effrayants ?
L’une des définitions les plus communément admises et les plus utiles nous est fournie par Alexander McFarlane et Giovanni de Girolamo, des Universités d’Adelaide en Australie et du Department of Mental Health [Département de la Santé Mentale – NdT] de Bologne, en Italie. Dans leurs écrits sur la répartition et les caractéristiques des réactions post-traumatiques au sein des populations humaines, McFarlane et de Girolamo affirment que, plus que simplement effrayantes ou douloureuses, les situations traumatisantes sont « des événements qui violent nos façons habituelles d’expliquer nos réactions, de structurer les perceptions que nous avons du comportement des autres, et de créer un cadre permettant d’interagir avec le monde extérieur en général. Toutes choses qui sont en partie déterminées par notre capacité à anticiper, nous protéger, et nous connaître nous-mêmes. »
Autrement dit, il est possible à quelqu’un de survivre à un terrible incendie de voisinage et d’en être bouleversé, mais pas traumatisé, parce que sa vision particulière du monde et des autres gens n’en est pas violée, et parce qu’il se sent capable d’y faire face ; d’autre part, il est également possible à quelqu’un d’autre d’être traumatisé par un feu de chaufferette, parce que cela contredit son idée de ce qui peut lui arriver, et parce que le feu le met face à sa propre impuissance.
Par définition, un événement traumatisant, qu’il soit ou non objectivement tragique, ouvre dans l’esprit un passage vers l’appréhension de notre propre impuissance primordiale et de la possibilité de la mort. Un événement stressant traumatisant est accablant pas parce qu’il est extraordinaire – car il pourrait ne pas le paraître à un observateur – mais parce qu’il revêt une certaine signification pour l’individu.
Prenons deux parachutistes. La parachutiste A pratique ce sport depuis des années. Le parachutiste B saute d’un avion pour la première fois. Au moment M, le parachutiste A actionne le dispositif permettant d’ouvrir son parachute. Le parachute ne s’ouvre pas. Cela le rend perplexe, parce qu’il est expérimenté, il sait préparer son matériel, et il pense que son parachute aurait dû s’ouvrir. Il devra revérifier son matériel une fois au sol. Mais il sait qu’il possède un parachute de secours en prévision de ce genre d’incident. Il attend encore trente secondes, savourant la chute libre, puis actionne son parachute d’urgence, qui s’ouvre immédiatement.
Le parachutiste B, au moment qu’on lui a désigné pour le faire, actionne le dispositif permettant d’ouvrir son parachute. Le parachute ne s’ouvre pas. Il n’arrive pas à y croire. Il se dit qu’il va mourir. Il se voit chuter, impuissant, à travers l’espace, et commence à hurler, même si l’air qui passe en sifflant autour de lui étouffe son cri. Pendant environ trente secondes, tandis que sa vie lui défile devant les yeux, il se démène pour trouver le parachute de secours. Il finit par l’activer, et le parachute s’ouvre immédiatement.
Pour le parachutiste A, un plongeon de plus. Pour le parachutiste B, un événement traumatisant, des cauchemars et des souvenirs intrusifs en perspective, peut-être pendant des années à venir. Pour un observateur, deux scènes plus ou moins identiques. Pour les participants, deux significations très différentes.
Ce qui compte ici, c’est le sens. Il détermine si oui ou non le passage mental vers l’impuissance et la mort va s’ouvrir, ou bien demeuré fermé et ignoré de nous, comme la plupart du temps. Et le sens que nous attribuons à un événement menaçant est déterminé en partie par « notre capacité à anticiper, nous protéger, et nous connaître nous-mêmes », pour reprendre les termes de McFarlane et Girolamo. Plus nous anticipons ce qui est susceptible de se passer, plus nous sentons que nous pouvons nous protéger, plus nous nous connaissons nous-mêmes en général, et plus nous sommes immunisés contre les traumatismes causés par des événements effrayants ou douloureux.
Il existe un large groupe de gens qui n’ont pratiquement aucun historique d’anticipation des événements, qui n’ont donc pratiquement aucune chance de se protéger, et qui possèdent une connaissance de soi minimale. Il s’agit des enfants, bien entendu. À cause de leur manque d’expérience de notre monde, les enfants sont traumatisés bien plus souvent que nous ne le sommes. Les circonstances qui provoqueraient une anxiété modérée chez un adulte peuvent facilement générer une terreur vitale chez un enfant, parce que les tout-petits ne se sont pas encore créé un « cadre fonctionnel permettant d’interagir avec le monde extérieur ». Cette lacune temporaire est l’une des connotations les plus poignantes et dangereuses de l’expression « innocence de l’enfance ». […]
En tant qu’adultes, nous sommes rarement capables d’apprécier la pleine mesure de notre naïveté primordiale. Un petit être a littéralement tout à apprendre : j’ai dix doigts ; l’eau, ça mouille ; mes jouets tombent par terre au lieu de flotter en l’air. Et, au fait, qu’est-ce donc que cette planète sur laquelle j’ai atterri ?
Une personne qui porte en elle tant de questions muettes est sensible et réceptive telle une fleur sous le soleil du matin. Elle est aussi à notre merci, et en danger.
Pour rendre les choses encore plus atroces aux petits, les capacités cognitives immatures de la prime enfance rendent difficile, voire impossible, la création après-coup d’un récit articulé permettant de rendre compte d’un événement menaçant. Un jeune enfant ne peut méditer sur ni donner un sens à un épisode traumatisant, sans parler de le rapporter de façon cohérente à quelqu’un qui pourrait l’aider à attacher des mots et un sens à ce qui s’est passé. Même le parachutiste novice malchanceux a pu comprendre ce qui lui était arrivé, s’en faire le récit dans sa tête, et éprouver quelque soulagement en racontant aux autres, peut-être de façon obsessionnelle pendant un temps, les trente secondes les plus effrayantes de sa vie. Le jeune enfant ne dispose pas d’un tel réconfort, il souffrira probablement en silence, impuissant, des conséquences d’un traumatisme, et se remémorera son expérience via les émotions et les réactions physiques, plutôt qu’avec les mots.
L’angoissante vérité est que même les bons parents attentifs et protecteurs peuvent être totalement ignorants de certaines souffrances subies par leurs enfants. En outre, les adultes ont tendance à minimiser les terreurs enfantines, même lorsqu’ils sont conscients de leur cause, simplement parce que celle-ci peut sembler inoffensive à des gens bénéficiant d’une plus grande expérience de la vie.
Pour rester sur le sujet des enfants non victimes d’abus (parce que, Dieu merci, les enfants non maltraités par leurs parents sont la majorité), considérons trois traumatismes d’enfance ordinaires – des événements qui ont suscité un traumatisme, plus qu’une simple peur ou douleur. Prenez quelques instants pour voir les choses avec les yeux de Dylan, cinq ans, qui descend du bus scolaire au mauvais arrêt, d’Amy, trois ans, qui subit une opération pour un palais fendu, et de Matthew, neuf ans, qui voit sa mère briser sous ses yeux toute sa vaisselle en porcelaine :
Dylan a commencé la maternelle mardi. Aujourd’hui, nous sommes mercredi. Il prend le bus scolaire pour la deuxième fois de sa vie. Il se sent un peu intimidé par le « grand » de dix ans assis à côté de lui, sa mère lui manque, et il n’est pas du tout sûr de savoir comment se comporter pour être un bon passager de bus. Pratiquement tout ce qui s’est passé depuis la veille était nouveau, et Dylan se sent épuisé ; il a hâte de retrouver le confortable canapé du foyer familial et ses vidéos de Couacs en Vrac. Sa mère lui a promis de l’attendre à l’arrêt de bus, exactement comme la veille. Il regarde, impatient, par la vitre tandis que le bus traverse des endroits qui lui semblent vaguement familiers.
Lorsque le bus s’arrête enfin, des grappes d’enfants bruyants, riants, se ruent en se bousculant vers la porte. Les enfants descendent dans un enchevêtrement impénétrable de têtes et de bras qui s’agitent. Parmi eux, un Dylan un peu perdu, mais qui s’efforce au maximum d’être un bon passager. Quelques adultes se trouvent sur le bord de la route. Ils accueillent les enfants, et en quelques secondes, le bus repart, et tout le monde s’éloigne de l’arrêt. Les gens s’éloignent, bavardant la main dans la main, et personne ne remarque le petit garçon de cinq ans resté tout seul.
Dylan ne pense même pas à héler les gens. Il est trop abasourdi, et puis, il ne les connaît pas. Il se tient là pendant un long moment, espérant que sa mère va apparaître. Il ressemble à une minuscule statue au bord de la route, jusqu’à ce qu’un énorme camion, klaxon mugissant, passe à toute vitesse devant lui, le forçant à faire un bond de côté. Il se heurte à un arbre. Parcourant le massif des yeux, il décide qu’il ferait mieux de s’y cacher jusqu’à ce que sa mère arrive.
Dylan s’assoit sous un orme, où, de la route, il est caché par un petit talus. Il étend ses jambes devant lui et s’adosse à l’arbre. Son nouveau sac-à-dos, qu’il a encore dans le dos, lui fait un léger coussin. Il regarde droit devant lui, et commence à taper ses nouvelles baskets l’une contre l’autre. Il a peur, mais il sait que sa mère va bientôt arriver. Il reste assis ainsi pendant environ une demi-heure – la durée d’un épisode de Couacs en Vrac – et pense alors à l’impensable : peut-être qu’elle ne va pas venir. Dès que cette pensée lui vient, il sent des sueurs froides lui parcourir le corps ; il a l’estomac noué, et il commence à pleurer. Bientôt, les larmes se transforment en sanglots désespérés. Des pleurs convulsifs, pendant plusieurs minutes, jusqu’à le faire haleter. Alors lui vient une idée. Il inspire à fond, se lève, et revient avec précaution au bord de la route, où il regarde autour de lui brièvement. Il appelle : « Maman ! », une fois d’abord, puis une deuxième fois, avec encore plus d’insistance : « Maman ! »
Dylan se trouve à environ un km de chez lui, dans une zone résidentielle agréable et tranquille. Tant qu’il reste en dehors de la route – ce qu’on lui a appris à faire – , il ne court aucun danger physique. Des maisons cossues se dressent tranquillement aux bouts des avenues qui relient la rue des deux côtés. En fait, tout ce que Dylan aurait à faire, c’est de remonter l’une des avenues et de frapper à une porte, qui, en toute probabilité, serait alors ouverte par un adulte sympathique qui contacterait rapidement sa mère. Mais le petit garçon de cinq ans ne sait pas cela. Au cours de sa courte vie sur Terre, il n’a jamais frappé à la porte d’un étranger. Il n’est jamais entré seul chez quelqu’un d’autre. Et dans son état actuel de panique, il ne réalise même pas que ces maisons silencieuses abritent des gens. Les maisons ne sont qu’un autre aspect de cet environnement impersonnel si effrayant pour lui.
Après avoir crié « Maman » plusieurs fois, il abandonne et retourne à son arbre derrière le talus. Le derrière de son pantalon est humide, à cause du sol. Il a froid, dans ce doux après-midi de septembre, et il frissonne. Il murmure « Maman » une fois, et quelques nouvelles larmes coulent sur ses joues. Puis il devient calme. Il reste assis silencieux sous
l’arbre, alors que l’énormité de la situation l’envahit. Il est perdu. Sa mère est partie. Il ne lui parlera plus jamais. Il ne rentrera jamais à la maison.
Il reste ainsi encore une heure de plus. Il commence à avoir l’impression que le monde est très lointain, et que lui n’est qu’un petit grain de poussière flottant quelque part dans un espace gris et flou. Il se demande, de façon détachée, s’il va mourir maintenant. Finalement, il ne ressent plus rien, pas même le froid ni les frissons. Son sac-à-dos toujours dans le dos, il se pelotonne en boule par terre, et dans son esprit, il disparaît complètement de lui-même et de son environnement.
Une autre heure passe. Dylan est ramené à lui lorsque sa mère se précipite sur les genoux, près de l’arbre, et le soulève dans ses bras. Plusieurs autres adultes sont là aussi. Sans émotion, Dylan dit : « Maman ? ». Sa mère sanglote et exulte à la fois. Elle ne remarque pas que Dylan, non.
Quelqu’un reconduit Dylan et sa mère chez eux. Il s’assoient sur la banquette arrière, où sa mère le serre et l’embrasse encore et encore, lui assurant que tout va bien. Dylan ne dit rien. Lorsqu’ils arrivent chez eux, sa mère passe plusieurs coups de fil émotionnels, puis prépare une soupe de poulet à Dylan. Voyant qu’il ne la mange pas, elle lui dit à nouveau que tout va bien. Elle lui assure qu’à partir de maintenant, elle ira le chercher elle-même à la maternelle. Plus de bus scolaire. Et puis, déconcertée, elle lui propose de s’asseoir ensemble sur le canapé douillet et de regarder l’une de ses vidéos. Elle se met tout contre lui, et il regarde le dessin animé. Il ne fait aucun commentaire ni ne se trémousse sur le canapé, comme il le fait d’habitude, mais elle sait qu’il doit être épuisé, et probablement encore effrayé. Elle aussi l’est.
Une fois le dessin animé terminé, elle trouve que Dylan a l’air pâle. Elle espère qu’il n’a pas pris froid, à force d’être resté assis sur le sol humide, et elle lui propose d’aller au lit tout de suite, bien qu’il soit encore tôt. Sans protester, Dylan laisse sa mère le mettre au lit, où il reprend sa position en boule.
Lorsque nous imaginons cet événement du point de vue de Dylan, nous comprenons qu’il est plus que fatigué et très effrayé. Il est traumatisé. Sa vision naissante du monde et des gens qui s’y trouvent a été violée, et sa capacité à y faire face a été totalement dépassée. À cinq ans, il a imaginé le visage de la mort, et a découvert que l’on pouvait faire cesser ces visions en se dissociant. Tout cela sans aucun danger objectif, et bien que l’histoire se termine bien.
Explorons maintenant l’esprit d’un autre enfant : Amy, trois ans, qui vient de subir une opération.
Les parents d’Amy l’aiment tendrement. Après sa naissance, lorsque le docteur a annoncé qu’elle avait un palais fendu, ils se sont juré de faire en sorte que les procédures médicales qu’elle aurait à subir seraient confortables et le moins traumatisantes possible pour elle. Il est maintenant deux heures du matin, le jour de l’opération d’Amy, opération destinée à améliorer son langage. Elle se réveille pour la première fois depuis l’opération, dans une chambre de clinique. Ses parents sont là, allongés sur des lits d’appoint à côté de son lit. Mais il fait noir dans la chambre, et Amy ne sait pas qu’ils sont là, ni où elle est. Groggy, la seule chose dont elle se rappelle est de s’être rendue avec ses parents dans un hôpital effrayant, et d’avoir reçu une piqûre. Elle se demande si elle est dans son lit à la maison. Elle commence à lever la tête, mais cela lui fait mal au cou – très mal. Elle étend les bras, et ils butent contre des choses dures et froides, des deux côtés. Effrayée, elle replie ses bras et reste allongée, calme. L’obscurité l’empêche heureusement de voir l’intraveineuse posée dans son bras gauche.
Enfin, elle se rappelle ce qu’on lui a dit sur l’opération et le séjour à l’hôpital. On lui a dit qu’elle dormirait dans un lit ici. Mais se rappeler ces informations ne l’aide pas. Elle a encore plus pleur. Pourquoi fait-il noir ? Est-ce la nuit ? À la maison, elle a une veilleuse. Elle veut une veilleuse, et elle veut sa mère. Elle essaie d’appeler « Maman », mais tout ce qui sort de sa bouche, c’est un son étouffé et faible, pas du tout « Maman ». Et pour une raison obscure, cela lui fait mal.
Elle arrête cette tentative, et reste étendue en silence. Alors, la véritable douleur commence. Amy ignore que les effets du médicament anti-douleur sont en train de s’estomper. Dans environ cinquante minutes, une infirmière entrera dans la pièce pour administrer d’autres anti-douleur ; mais ces cinquante minutes vont paraître longues à Amy. La douleur commence à envahir sa bouche et sa tête, tellement qu’elle ne peut le supporter. Que se passe-t-il ? Pourquoi sa tête lui fait-elle aussi mal ? Ses yeux se gonflent de larmes, qui coulent, ruisselantes, sur ses joues. La chambre est sombre ; elle n’y voit rien. Et elle est seule.
Elle reste aussi immobile que possible, et tente de comprendre. Qu’est-ce qui ne va pas chez elle ? Qu’est-ce que Papa et Maman ont dit à ce sujet ? Quelque chose à propos de sa bouche, de son « palais », répétaient-ils. Qu’est-ce donc ? Elle ne s’en rappelle pas. Mais elle se rappelle qu’elle n’est pas comme les autres enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle se rappelle que quelque chose ne va pas du tout chez elle.
La douleur empire, et Amy se demande si elle est en train de mourir, comme lorsqu’on a dû endormir Winston à la clinique vétérinaire. Peut-être que Maman et Papa l’ont laissée là tout comme ils ont laissé Winston. Lui aussi avait quelque chose de pas normal. Elle tente d’appeler à nouveau, mais aucun son ne sort, seulement la douleur. Mais maintenant, cela fait tellement mal qu’elle peut à peine respirer. Elle rampe à l’intérieur de sa tête et observe la douleur. C’est une lumière brillante, qui devient de plus en plus brillante à mesure qu’elle l’observe. Au bout d’une ou deux minutes, le corps d’Amy semble disparaître, et il ne reste que la lumière.
Lorsque l’infirmière arrive à l’heure dite pour administrer l’anti-douleur, la température d’Amy est tombée à 35,5°. Pensant qu’elle est endormie – elle est si calme – , l’infirmière étend doucement une autre couverture sur son lit. Alors, elle se rend compte qu’Amy a les yeux ouverts. Ayant promis aux parents qu’elle les avertirait, l’infirmière allume une lumière tamisée et secoue doucement les parents d’Amy, allongés sur leurs lits d’appoint, où, épuisés, ils s’étaient endormis. Ils se redressent immédiatement sur leurs lits. La mère, voyant que le visage et les cheveux de la petite fille sont humides, se demande, consternée, si elle est restée là allongée à pleurer.
La mère d’Amy lui presse la main et lui murmure à l’oreille : « Maman et Papa sont là, ma chérie. L’opération est finie. Tu as été formidable. Tout va bien. » Une autre histoire qui finit bien. Les parents aimants d’Amy la ramènent à la maison, où ils continuent à prendre soin d’elle attentivement.
Elle ne leur parlera jamais de ces cinquante minutes de terreur ; la petite fille de trois ans n’a aucun mot pour cela. Et ses parents ne tenteront jamais de la persuader de parler, parce que, de leur point de vue, il ne s’est rien passé.
Enfin, imaginons la vie intérieure de Matthew, neuf ans, dont les parents, vindicatifs et en plein conflit, se hurlent souvent dessus à la maison. Les querelles sont la plupart du temps verbales, mais pour Matthew, témoin de ces conflits, ces derniers sont souvent très effrayants, en dépit de l’absence habituelle de violence physique. Il a peur que sa famille ne se brise. Il se demande ce qui lui arrivera. Et, comme tous les enfants, il pense que d’une certaine façon, tout est de sa faute.
Sa mère, en particulier, est rageuse et impulsive. Lorsqu’elle est furieuse, elle se transforme en quelqu’un d’autre. Son visage se tord, ses poings se serrent, et on dirait qu’elle va tuer quelqu’un. D’ailleurs, lorsqu’elle se bagarre avec son mari, elle dit souvent qu’un jour, elle va le tuer. À chaque fois que Matthew entend cette déclaration, il se sent vide et comme anesthésié.
Ce soir-là, le père de Matthew s’est rué hors de la maison et est parti en voiture, au milieu d’une nouvelle dispute bruyante et brutale. Un Matthew en larmes se cache dans sa chambre, faisant semblant de regarder la télé. Lorsqu’il entend son père partir, il descend sur la pointe des pieds dans la cuisine pour voir ce qui se passe. Sa mère se tient là, devant l’évier, les mains agrippant le rebord. Ses épaules se soulèvent ; elle marmonne des horreurs. Matthew décide de retourner dans sa chambre, mais avant qu’il ait pu sortir, sa mère fait volte-face et se met à hurler les mêmes insultes à pleins poumons. Elle tremble de tout son corps. Elle balaie la cuisine du regard pendant un instant, jusqu’à ce que ses yeux se posent sur un grand pichet en porcelaine – l’un de ses objets de valeur. Sous les yeux d’un Matthew pétrifié d’horreur, elle attrape le pichet et le lance contre un mur. Le pichet vole en éclats, qui se répandant partout sur le sol.
C’est alors qu’elle remarque Matthew. Elle dit : « Bonjour, fils. Regarde ça. » Et devant un Matthew pris de stupeur, elle ouvre d’un coup sec les vitres du vaisselier qui contient sa porcelaine de mariage sertie d’or, et se met à lancer toutes les assiettes, l’une après l’autre, contre le mur, à la manière d’un lanceur de disques. Elle ponctue chaque destruction d’une épithète du genre : « Sale vermine ! » En quelques minutes, le sol de la cuisine est parsemé d’éclats de porcelaine brisée. Lorsque toutes les assiettes sont par terre, elle s’assoit sur le carrelage, à côté des dégâts qu’elle a fait, et se met à pleurer.
Tremblant manifestement du fait que sa mère, cette adulte incontestable, semble être totalement hors de contrôle, Matthew prend un balai et une pelle et tente de remettre un peu d’ordre. Il dépose toute la porcelaine brisée dans trois grand sacs en papier.
Au bout d’un moment, sa mère se calme, et le remercie.
Le lendemain matin, quand Matthew se lève et commence à s’habiller, il se rappelle avec chagrin que ses parents ont eu une autre dispute la nuit dernière. Il pense que son père
est parti en plein milieu, mais il n’en est pas sûr. Il ne se rappelle pas être descendu après avoir entendu la voiture de son père s’éloigner. Il n’a aucun souvenir de la débâcle qui a eu lieu dans la cuisine. Il croit qu’il a passé la soirée à regarder la télé dans sa chambre, bien que, perplexe, il n’arrive pas à se rappeler les programmes diffusés.
Matthew se rend à l’école, il est déprimé à cause de la dispute, mais il ne se rappellera jamais la scène qui l’a tellement bouleversé et l’a amené à sortir de lui-même. Et ses parents ne se préoccuperont jamais de son bien-être psychologique ni ne lui demanderont comment il vit cette situation chaotique à la maison. Ils ont trop de problèmes à régler de leur côté.
Dylan, Amy et Matthew ont vécu des situations que la plupart des adultes, en regardant de l’extérieur, qualifieraient d’« horribles », de « tellement effrayantes », ou peut-être de « dangereuses ». Mais pour les enfants, ces événements sont plus qu’horribles ; ils sont traumatisants. Ces trois enfants n’ont pas été intentionnellement abusés… mais leur système d’interprétation immature a été violé, et leurs stratégies d’auto-protection limitées ont été mises à l’épreuve, testées jusqu’au point de rupture. Même si l’expérience fut brève, le passage vers l’annihilation s’est ouvert en chacune de ces jeunes âmes. Mais une fois adultes, ni Dylan, ni Amy, ni même Matthew, neuf ans, n’auront conservé de souvenirs intelligibles des épisodes traumatisants de leurs vies. Lorsqu’ils seront grands, si jamais quelqu’un leur demande s’ils ont été traumatisés dans leur enfance, ils – comme la plupart d’entre nous – répondront avec assurance : « Non, bien sûr que non. »
Voilà donc quelques illustrations de traumatismes précoces passant inaperçus et marquant la vie d’enfants non maltraités vivant dans des quartiers tranquilles dans le monde civilisé. C’est suffisamment troublant. Mais plus glaçant encore : les traumatismes ont un second mécanisme encore plus caché. Non seulement ils peuvent affecter enfants comme adultes directement, comme dans les traumatismes précoces, mais ils peuvent aussi agir indirectement, passer furtivement de l’esprit d’une personne à celui d’une autre, traverser le temps et l’espace. « Traumatisme secondaire », ou indirect, est l’expression la plus souvent utilisée par les psychothérapeutes pour désigner la possibilité qu’une personne (par exemple, un psychothérapeute) commence à présenter des signes importants de stress post-traumatique simplement en entendant des récits d’expériences traumatisantes vécues par d’autres (par exemple, les patients victimes de traumatismes). Mais les traumatismes secondaires s’infiltrent également, insidieusement, dans les vies de personnes qui ne sont pas psychothérapeutes et qui ne traitent pas de patients victimes de traumatismes ; cela pour la simple raison que, dans un monde où trop d’enfants n’ont jamais dormi dans un vrai lit, la misère humaine extrême n’est jamais éloignée de soi.
En 1993, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont annoncé dans le Rapport sur les catastrophes dans le monde que durant le quart de siècle compris entre 1967 et 1991, les désastres survenus dans les divers endroits du monde avaient tué sept millions de personnes, et en avaient directement affecté trois milliards. Dans le même rapport, la Croix-Rouge estimait que, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1991, environ quarante millions de personne avaient été tuées dans des guerres et des conflits – ces éternels désastres d’origine humaine.
De fait, en considérant les choses avec une froide objectivité, nous constatons que nous sommes une espèce en état de choc.
Si nous sortons un peu du monde « civilisé », nous découvrons que plus d’un cinquième de la population mondiale vit encore dans l’extrême pauvreté, et que l’espérance de vie dans certains des pays les moins développés est de quarante-trois ans. Pas moins d’un milliard de personnes vivant actuellement sur la planète souffrent de faim chronique, et un enfant meurt de malnutrition toutes les quatre secondes. L’OMS rapporte que la moitié de l’humanité n’a toujours pas accès régulier aux soins pour des maladies communes ni aux médicaments les plus basiques.
Tant en termes d’espace que de temps, nous ne sommes pas très éloignés de degrés de souffrance humaine similaires, bien que nous méditions rarement sur la question. Si l’on devait comparer l’histoire de l’humanité à une heure, le soi-disant monde civilisé ne serait vieux que de quelques secondes. Nombre de nos arrière-grands-parents, et même certains de nos grands-parents, ont vécu la plus grande partie de leur vie dans des conditions que nous jugerions insupportables.
L’horreur ordinaire n’est qu’à deux ou trois générations de nous, et dans certains endroits, elle subsiste encore. L’Holocauste est toujours dans les mémoires. D’autres plans de génocide ethnique sont actuellement mis en oeuvre alors que j’écris ces mots. Et la plupart d’entre nous ont entendu des histoires, généralement lorsqu’ils étaient enfants, et souvent de la bouche de proches. Pour certains, les récits ne se résumaient qu’à des choses du genre : « nous devions faire 8 km à pieds dans la neige pour aller à l’école. » Mais pour d’autres, ces récits parlaient de survivre à la faim quotidienne, à une guerre, ou à un camp de la mort.
L’un des exemples les plus poignants de traumatisme secondaire dont j’aie jamais été témoin concerne une de mes patientes qui avait déjà été traitée par différents thérapeutes à cause d’un cauchemar très intense. Ce cauchemar perturbait son sommeil chaque nuit, la rendant insomniaque chronique, l’épuisant.
Magda, quarante-quatre ans, était la petite-fille d’un médecin polonais dont la fille – la mère de Magda – avait émigré aux États-Unis juste après la Seconde Guerre mondiale. À son départ d’Europe, la mère de Magda était la seule survivante d’une grande famille qui avait été décimée dans les camps.
Le père de Magda était un médecin américain, que sa mère avait rencontré peu après son arrivée, alors qu’il était encore étudiant. Grâce à son père, Magda avait eu une enfance et une adolescence privilégiée, dans un cadre idyllique dans l’ouest du Massachusetts ; et grâce à sa mère, elle avait été traitée avec douceur et excessivement couvée.
« Les visites au salon de coiffure étaient toute une affaire. Elle veillait toujours à me faire coiffer, même quand j’étais toute petite. »
Adulte, Magda portait ses cheveux bruns très longs, arrangés en une natte africaine élaborée.
Lorsque je demandai un jour à Magda si elle avait été traumatisée, elle me répondit dans un Anglais sans accent : « Non, bien sûr que non. Rien de tel. » Mais pour quelque raison, et en dépit de sa grande intelligence et de ses éminents aïeux, Magda n’avait pas satisfait aux ambitions que sa famille avait pour elle. Enfant, elle avait voulu être médecin, comme son père et son légendaire grand-père. Au lieu de cela, elle avait abandonné l’Université d’Harvard en premier cycle, et avait passé plus de vingt ans à être hantée par son cauchemar, souffrant par intermittence de grave dépression et s’en sortant difficilement en tant qu’aide-soignante.
« C’est l’histoire que m’a racontée ma mère », expliqua-t-elle, le visage cireux et triste, « sauf que ce n’est pas ma mère. C’est moi.
– C’est vous ? Vous voulez dire que c’est vous dans le rêve ?
– Oui. C’est ce qui est arrivé à ma mère, sauf que c’est à moi que ça arrive. Encore et encore, chaque nuit.
– Votre mère vous a raconté une histoire à propos de ce qui lui arrivé pendant la guerre ?
– Oh oui, de nombreuses fois. Toujours la même histoire, à propos du camp.
– Quel âge aviez-vous lorsqu’elle vous l’a racontée pour la première fois ?
– Je ne saurais dire. Je ne me rappelle pas un temps où je ne la connaissais pas. Je devais être toute petite.
– Et c’est toujours le même rêve ?
– Toujours le même. Toujours aussi cauchemardesque. Je suis avec plein de monde, dans une longue file. Je suis nue et j’ai vraiment très froid. On me pousse à terre, et je vois qu’ils emmènent ma mère et mon père. Je hurle « Maman ! », mais quelqu’un me frappe très fort. Je me réveille en hurlant. Je me réveille en hurlant toutes les nuits.
– C’est exactement ce que votre mère vous a raconté à propos de ce qui lui est arrivé ?
– Oui, exactement… sauf que, sauf qu’elle n’était pas une toute petite fille, et que dans mon rêve, je suis une toute petite fille.
– C’est absolument terrifiant. Lorsque vous vous réveillez en hurlant, que faites-vous ?
– Je me lève et j’arpente mon appartement. J’allume toutes les lumières et je touche des objets, je touche mon grand canapé et les rideaux soyeux. Je touche les touches de mon téléphone, dans la cuisine, ce genre de choses. J’ai besoin de choses qui me ramènent dans l’ici et maintenant. Ce rêve est tellement réel. Après avoir fait ça pendant un moment, j’ai l’impression que je commence à m’engourdir. Je ne suis plus effrayée par le rêve – au lieu de ça, je deviens, euh, c’est comme si je ne ressentais plus rien. Je me réveille souvent sur le canapé le matin. »
Magda était tourmentée par ce rêve chaque nuit de sa vie, et nos progrès étaient très lents.
Alors qu’elle était encore jeune, elle avait fait le voeu de ne jamais avoir d’enfants. Durant une séance, lorsque je lui avais demandé pourquoi, elle avait répondu sans hésitation que le monde était tout bonnement trop dangereux pour les enfants.
« Mais vous vivez en Nouvelle-Angleterre, avais-je répondu, et la Seconde Guerre mondiale est si loin.
– Vous avez raison, bien entendu », avait-elle répondu avant de porter son regard au loin, fixant en silence une chaise vide de l’autre côté de la pièce.

 Amériques
Amériques États-Unis
États-Unis Les NATIONS
Les NATIONS QUI ose parler
QUI ose parler Thème - CONTROLE MENTAL
Thème - CONTROLE MENTAL